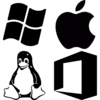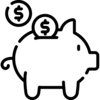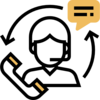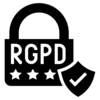Renforcer la cybersécurité des entreprises : 7 pratiques essentielles à intégrer
Face à l’intensification des cyberattaques, la sécurité des systèmes d’information ne peut plus être traitée uniquement sous l’angle des outils. Ce sont les pratiques, les processus et la rigueur opérationnelle qui permettent de bâtir une véritable posture de défense.
Voici 7 recommandations clés à mettre en œuvre dans tout environnement professionnel, du PME au groupe multisite, pour élever le niveau de sécurité sans complexité excessive.
1. Préférer les phrases de passe à des mots de passe complexes
Les mots de passe trop courts ou composés de caractères spéciaux aléatoires sont difficiles à mémoriser, ce qui entraîne souvent des comportements à risque (stockage non sécurisé, répétition sur plusieurs comptes). L’usage de phrases de passe longues, compréhensibles et personnalisées améliore la sécurité tout en restant facilement utilisable.
Par exemple : JeSauvegardeMesDonnéesAvecKiwiEn2025! est bien plus robuste et mémorisable que R#8d!xz2.
L’ajout de l’authentification multifactorielle (MFA) sur les accès critiques vient renforcer considérablement cette première couche de protection.
2. Utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé
Beaucoup d’organisations stockent encore leurs identifiants dans des documents bureautiques ou partagés sans chiffrement. Une solution de gestion de mots de passe permet de centraliser les accès dans un coffre-fort chiffré, avec une authentification forte à l’entrée. Cela réduit les erreurs humaines, tout en facilitant le contrôle d’accès à l’échelle de l’entreprise.
Pour les environnements soumis à des exigences réglementaires, un gestionnaire local est souvent recommandé. Les structures en télétravail ou multi-sites préféreront des solutions cloud certifiées, avec chiffrement de bout en bout.
3. Sécuriser les connexions via VPN et limiter l’usage du Wi-Fi public
Les connexions depuis des réseaux publics non sécurisés exposent à des attaques de type interception. En déplacement ou en télétravail, il est fortement conseillé d’utiliser une connexion via un VPN professionnel pour chiffrer les échanges de données.
Même lors d’usages ponctuels, mieux vaut éviter toute interaction avec des données sensibles en Wi-Fi public, sauf si un VPN est actif. Cela inclut les accès aux messageries professionnelles, fichiers partagés et outils métier.
4. Mettre en place une vraie stratégie de sauvegarde selon la méthode 3-2-1
En cas d’attaque par ransomware ou de défaillance technique, la capacité à restaurer rapidement et intégralement les données est critique.
La méthode 3-2-1 reste une référence fiable :
- Trois copies des données (production + deux copies de sauvegarde
- Deux types de supports (par exemple, NAS / disque local + cloud
- Une copie externalisée, hors site ou isolée du réseau principal
Tester régulièrement les restaurations est indispensable pour s’assurer que la stratégie de sauvegarde est réellement opérationnelle.
5. Industrialiser et prioriser les mises à jour de sécurité
Les vulnérabilités non corrigées représentent l’un des vecteurs d’attaque les plus exploités. La mise à jour proactive des systèmes, applications et composants tiers (navigateur, plugins, bibliothèques open source) est une mesure défensive incontournable.
Dans les environnements complexes, il est pertinent de prioriser les vulnérabilités critiques identifiées dans les bases CVE et de déployer des outils d’analyse de vulnérabilités pour suivre les écarts dans le temps.
6. Identifier précisément les données sensibles et contrôler les accès
Un grand nombre d’entreprises ne savent pas exactement quelles données elles hébergent, où elles sont stockées, ni qui y a accès. Cela peut entraîner des fuites accidentelles, notamment via des outils d’IA ou de collaboration mal configurés.
Mettre en œuvre une classification des données et une politique d’accès basée sur le principe du moindre privilège est essentiel. Des revues régulières des droits, y compris sur les espaces collaboratifs (SharePoint, Google Drive, OneDrive, etc.), permettent de limiter les risques de compromission involontaire.
7. Formaliser un plan de réponse aux incidents
Malgré toutes les précautions, un incident de sécurité peut survenir. Il est donc essentiel de disposer d’un plan de réponse clair et documenté.
Ce plan doit inclure :
- Une chaîne de décision définie,
- Des moyens de communication alternatifs en cas d’indisponibilité (email, serveurs),
- Un processus de restauration rapide à partir des sauvegardes,
- Un protocole de notification en cas de violation de données (notamment dans le cadre du RGPD)
L’intégration d’une solution de détection avancée — comme une plateforme XDR, qui centralise la réponse aux incidents grâce à l’intelligence artificielle, ou un système SIEM, qui agrège et analyse les données de l’environnement informatique pour identifier les menaces furtives — permet de gagner en visibilité sur l’origine et la portée des attaques, facilitant ainsi les actions correctives et le respect des obligations de déclaration.
Conclusion
La cybersécurité ne repose pas uniquement sur la technologie. Elle dépend aussi fortement des pratiques quotidiennes et des mesures simples, mises en œuvre avec rigueur.
La sauvegarde fait partie de ces piliers. Elle ne doit pas être pensée comme une tâche secondaire, mais comme un élément clé de la continuité d’activité.
Avec Kiwi Backup, les entreprises disposent d’une solution de sauvegarde professionnelle, fiable, conforme aux standards de sécurité les plus élevés. C’est une réponse concrète aux enjeux de résilience, de protection des données et de conformité réglementaire.
Investir dans une solution de sauvegarde automatisée et sécurisée constitue aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces pour minimiser l’impact d’une attaque et assurer la résilience de son infrastructure informatique.